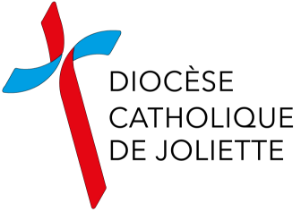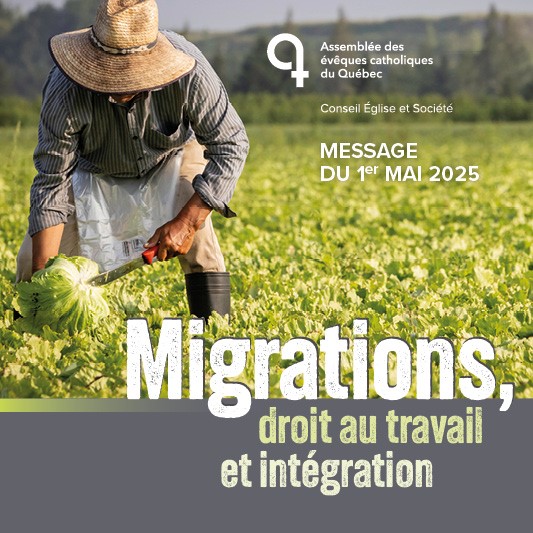MIGRATIONS, DROIT AU TRAVAIL ET INTÉGRATION
« Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas,
car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte » (Exode 22, 20)
Le 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, est aussi la fête de saint Joseph travailleur, un artisan qui a dû émigrer avec sa famille pour la protéger. Un homme qui, quelques années plus tard, n’a pu revenir dans son pays qu’en s’établissant dans une région autre que celle qu’il avait quittée[i]. Deux mille ans après cet exil rappelant celui des Hébreux en Égypte, et quatre cent ans après la désignation de saint Joseph en tant que patron de la Nouvelle-France, faire mémoire de ce charpentier est pour nous l’occasion d’inviter la population québécoise à faire preuve d’une hospitalité renouvelée envers les personnes migrantes. Cela passe notamment par le fait de faciliter leur accès à un travail décent et stable qui favorise leur intégration[ii]. C’est aussi l’occasion de reconnaître l’apport des personnes migrantes à la vie de nos communautés. Bénévoles, agentes ou agents en pastorale, prêtres, diacres ainsi que participantes et participants aux célébrations chrétiennes sont nombreux à venir d’autres régions du monde. La présence de ces femmes, de ces hommes et de ces familles contribue de façon importante au dynamisme et à la vitalité des paroisses au Québec.
Au détour d’une discussion ou dans les médias, il est toutefois fréquent d’entendre que « nous en faisons déjà assez », ou même que « nous en faisons trop », au Québec, pour les personnes migrantes. Dans le débat public, leurs besoins sont même parfois comparés et mis en concurrence avec ceux de personnes vulnérables. Cette perception méfiante devrait faire place à une préoccupation sincère et constante pour la dignité inhérente et inaliénable de chaque personne humaine. C’est ainsi que nous pourrons offrir ici le type d’hospitalité dont nous souhaitons bénéficier ailleurs, si nous avons à migrer à notre tour.
Regard sur la situation actuelle
Nous constatons que les conditions de vie et de travail des personnes migrantes sont directement liées aux transformations économiques rapides vécues au Québec. Selon les données des recensements de 2006 et 2016, le taux d’emploi et le revenu moyen d’emploi des femmes immigrantes vivant au Québec (nées dans un autre pays, mais ayant obtenu la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne) sont significativement inférieurs à ceux des non-immigrantes[i]. En 2022, le taux d’emploi des personnes immigrantes a légèrement dépassé celui des personnes nées au Québec, mais cela « s’explique particulièrement par la catégorie des immigrants âgés de 55 ans et plus[ii] », qui prennent leur retraite plus tardivement. En 2024, le taux de chômage des personnes nouvellement arrivées et des jeunes a augmenté et atteint le double du taux national au Québec[iii]. Cette difficulté s’ajoute aux défis à l’emploi bien documentés que sont les faits d’appartenir à une minorité visible et d’avoir obtenu ses diplômes dans un autre pays[iv].
La migration occupe une place importante dans le débat public au Québec. Cela n’est pas sans lien avec la hausse notable du nombre d’immigrants permanents et de résidents non permanents accueillis dans la province en 2022 et 2023, qui sert d’assise aux discussions récentes sur l’abaissement des seuils d’immigration[v]. Lors de la pandémie de la Covid-19, le rôle essentiel de plusieurs personnes nées dans un autre pays et travaillant dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’alimentation a été souligné avec empathie. Aujourd’hui, ces mêmes personnes qui avaient été qualifiées d’« anges-gardiens » se voient parfois attribuer la responsabilité de situations critiques dont les causes sont en vérité complexes : crise du logement, déclin du français, inflation, engorgement des urgences hospitalières, manque de places en garderie, manque d’espace et de personnel enseignant dans les écoles, etc.
Plusieurs organismes communautaires dénoncent cette instrumentalisation des personnes migrantes comme boucs-émissaires et les iniquités qu’elles doivent subir en ce qui a trait à leurs conditions de travail, ainsi qu’à l’accès aux soins et aux programmes sociaux. Permis de travail fermé pour les travailleurs migrants temporaires, délais considérables pour que les demandeurs d’asile aient accès à un permis de travail, non reconnaissance des diplômes, coupures majeures en francisation, la liste est longue de ce qui porte atteinte à la dignité de ces personnes.
Ces injustices ont des effets négatifs sur les conditions de vie de ces personnes et leur intégration au marché du travail. Il est paradoxal de questionner le niveau d’intégration de certaines personnes migrantes sans leur donner un accès adéquat à ce qui permet celle-ci! Comment s’intégrer sans accès à une activité, notamment le travail, et sans pouvoir apprendre la langue française? Comment vouloir et pouvoir être une citoyenne ou un citoyen impliqué et enraciné dans sa communauté d’accueil sans avoir la garantie que sa situation sera stabilisée, qu’une personne migrante qui le souhaite pourra immigrer de façon durable?
Comprendre à la lumière de notre espérance
En choisissant pour le présent message le thème des migrations, du droit au travail et de l’intégration, nous répondons notamment à l’invitation faite récemment à l’Église au Québec par l’envoyé spécial du Saint-Père pour les fêtes du 350e anniversaire du diocèse de Québec : « Tiens-toi en priorité sur les lignes de fracture qui traversent la société québécoise aujourd’hui, qu’elles soient d’ordre économique, culturel ou religieux. » Dans la dernière décennie, les évêques catholiques du Québec et du Canada ont pris la parole à plusieurs reprises, avec leurs collaboratrices et collaborateurs, pour rappeler le devoir d’hospitalité des chrétiennes et des chrétiens envers les personnes migrantes. Nous perpétuons ainsi une longue tradition qui va de la Parole de Dieu dans l’Ancien Testament aux actions quotidiennes de comités, de paroisses, de diocèses et d’organisations catholiques qui parrainent des réfugiés. Cette tradition passe aussi par les Évangiles et des engagements personnels et communautaires de chrétiennes et de chrétiens qui s’en inspirent, en solidarité avec les personnes migrantes.
Avec le pape François, nous mettons de l’avant une approche de l’hospitalité axée sur quatre verbes d’action : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Cette approche découle de l’engagement sans faille du Christ pour les personnes vulnérables, Lui qui prend entre autres la figure de l’Étranger que nous accueillons. Sur ce plan de l’accueil, le pape François citait en 2018 « le principe de la centralité de la personne humaine », affirmé par le pape Benoît XVI, comme ce qui « nous oblige à toujours faire passer la sécurité personnelle avant la sécurité nationale », et les évêques canadiens écrivaient dès 2006 que « l’enseignement catholique voit, dans les lois et les politiques donnant la préséance à l’intérêt national sur la dignité humaine des personnes, une inversion fondamentale des valeurs.»
Dans le contexte québécois contemporain, cet enseignement pourra surprendre, voire inquiéter celles et ceux qui estiment que la « capacité d’intégration » de la société québécoise est présentement dépassée. Or, sur ce plan, le pape François insiste aussi sur « la nécessité de favoriser, dans tous les cas, la culture de la rencontre, en multipliant les opportunités d’échange interculturel, en documentant et en diffusant les ”bonnes pratiques“ d’intégration et en développant des programmes visant à préparer les communautés locales aux processus d’intégration[. » En faisons-nous véritablement assez, à cet égard?
En faire plus
Aujourd’hui, l’Église catholique au Québec encourage l’intégration des chrétiennes et chrétiens migrants dans toutes les paroisses, ainsi que l’accueil généreux, dans les quartiers, les villages et les villes, de toutes les personnes, quelle que soit leur origine et leur religion. L’Église soutient aussi des initiatives plus ciblées, comme le Carrefour québécois d’hospitalité presbytérale qui vise depuis 2019 à favoriser l’intégration des prêtres nés dans d’autres régions du monde, venus en mission au Québec participer pour un temps à la vie de nos communautés. L’Église soutient par ailleurs des initiatives d’intégration portées par des organismes communautaires sans égard à la foi, dont le développement d’activités de socialisation, de sensibilisation et de défense des droits par le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ) dans plusieurs régions de la province.
Collectivement, dans l’ensemble de la société québécoise, la culture de la rencontre pourrait être plus valorisée, sachant que le repli sur soi demeure une tentation. En raison de la dignité fondamentale de toutes et tous, aucune personne ne devrait être traitée comme un simple moyen dans une joute partisane ou un projet économique. Évitons toute instrumentalisation des personnes migrantes et demandons-nous plutôt comment traiter dignement chaque personne. Voici quelques pistes d’actions en ce sens, sur le plan personnel et sur le plan collectif.
Personnellement :
- Porter une attention particulière aux façons dont je participe aux conversations privées et au débat public sur la place des personnes migrantes, afin de promouvoir leur dignité en adoptant une attitude bienveillante;
- Mettre en lumière la contribution des personnes nouvellement arrivées dans mon milieu. Dans ma paroisse, mon lieu de travail, mes espaces de loisir, là où je reçois des soins, etc., reconnaître leurs apports avec gratitude;
- Vérifier si des personnes de ma paroisse ou de mon quartier peinent à obtenir un permis de travail, à trouver un emploi ou à trouver des ressources pour apprendre le français. Les soutenir concrètement si c’est le cas. Pourquoi ne pas offrir à une personne de converser en français? Si je lui reconnais certaines qualités, lui offrir d’être une référence pour un emploi. Ou encore, lui faire connaître les offres d’emploi que je croise. Ces petits gestes concrets font une véritable différence!
Collectivement :
- Organiser dans nos paroisses et diocèses, ainsi que dans les réseaux dans lesquels nous nous impliquons, des activités de sensibilisation aux réalités vécues par les personnes migrantes au Québec, en commençant par faire circuler le présent message du 1er mai;
- S’informer et soutenir des campagnes de justice sociale et de changements structurels, notamment sur les enjeux liés au permis de travail fermé ou ouvert, l’importance des programmes de parrainage des personnes réfugiées, la nécessité des programmes de francisation et l’accès équitable aux programmes sociaux et aux soins de santé;
- Appuyer des organismes communautaires et ecclésiaux qui œuvrent, à l’échelle locale, régionale ou provinciale, pour l’accueil, la protection, la promotion et l’intégration des personnes migrantes, comme le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ) et le Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale.
Ce message a été préparé par le conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, en collaboration avec la Table de pastorale sociale des diocèses du Québec.
Informations : Simon Labrecque – slabrecque@evequescatholiques.quebec